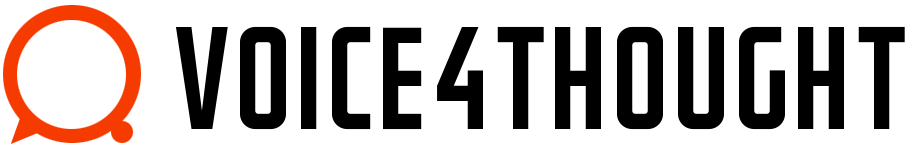Je connais Yeli depuis quelques mois. Depuis que j’habite à Medellín, je me fais faire les ongles par elle tous les quinze jours. Elle est sévère avec moi. Agacée, elle regarde les plaies à mes pieds. Elle me montre les tongs bon marché que je porte avec ses longs ongles en acrylique couverts de paillettes et de petits diamants. Je sais que je lui plais. Quand elle me voit marcher dans la rue, elle m’interpelle : “Jasmine, rends-moi service et marche comme un mannequin”. Elle me montre comment faire. Du salon de beauté j’entends les rires de ses collègues.
Elle est parfois nostalgique lorsqu’elle parle de son pays natal. De son enfance à Caracas, les gens, la nourriture. De ses vacances à la côte. Avec des plages comme en Colombie, mais deux fois plus belles. Un jour, elle a décidé de fuir. Elle fait partie des millions de Vénézuéliens qui ont traversé la frontière à pied. Avec sa nièce, une petite fille qui avait 10 ans à l’époque.
Des rencontres comme celle-ci m’ont souvent amené à me demander ce que c’est que d’être Vénézuélien dans un des pays environnants. Que vous ayez dû quitter le pays que vous aimiez tant parce que vous craigniez pour votre vie. Que vous ayez fait le choix d’aller en Colombie à pied. Avec des enfants. Avec toute une famille. Ou tout simplement seul. Et puis, à quel point vous êtes indésirable. Que vous devez lutter chaque jour contre les stéréotypes. Contre la haine collective envers les réfugiés vénézuéliens.
Lorsque je raconte à Yeli que récemment j’ai pris le bus pour visiter sa ville natale, elle me déclare folle. Je suis d’accord avec elle. Elle se met à rire. Ses collègues rient avec elle.
Le chien policier nous a foncé dessus. Il a mordu dans la poche de mon ami Jordi. Les officiers lui ont ordonné de sortir du bus. Je l’ai vu de derrière la fenêtre. Il se tenait debout contre le mur, les mains et les jambes écartées. Ils se disputaient. Il a reçu un coup de poing, dur comme de la pierre, dans l’estomac.
Un homme en uniforme m’a demandé mon passeport. Il voulait savoir si je parlais espagnol. Ce que je faisais ici? Qui m’avait invité? Parce qu’il faut une lettre d’invitation pour entrer légalement dans le pays. Un bout de papier que j’avais acheté pour quelques centimes de dollars à un homme qui m’avait aidé à obtenir un visa. Le genre de modèle commercial qui ne peut exister qu’à la frontière. En Amérique latine, les zones frontalières sont toujours capricieuses. Il est préférable de ne pas s’y trouver. Nulle part les extrêmes ne sont aussi proches. Nulle part ailleurs, le passage de la légalité à l’illégalité n’est aussi petit et aussi visible.
Je n’ai pas retrouvé ce papier. J’ai dit qu’une amie de Jordi m’avait invitée. Mais que j’avais oublié son nom. Il me dit que mon amie va aller en prison. Il m’a demandé si je comprenais ce que cela signifiait. Pendant qu’il me tournait le dos un instant, une femme m’a chuchoté de cacher mon argent. J’ai mis vingt dollars dans ma chaussette lorsque Jordi est remonté dans le bus et qu’il m’a demandé avec anxiété si j’en avais.
Nous venions à peine d’arriver au Venezuela. Il nous faudrait encore au moins vingt-quatre heures pour arriver à Caracas dans un bus surchargé et surchauffé, les gens couchés sur le sol. Nous devions remettre tous nos dollars à la police des frontières. Sinon, mon ami serait mis en prison. Au Venezuela, cela signifiait que personne n’entendrait plus jamais parler de lui. Qu’il disparaîtrait.
Pendant le reste du voyage, ils nous ont encore arrêtés une douzaine de fois. À chaque fois, nous devions payer. Des fois tous les voyageurs. D’autres fois, la police a obligé au hasard des personnes à quitter le véhicule et, comme Jordi, les a intimidées pour qu’elles leur remettent tout.
À Caracas, souvent j’ai repensé à ce chien policier. En buvant un café sur le balcon du dix-huitième étage. Je me demandais si ce chien ne sentait pas plus tôt les dollars que la drogue. De derrière les barreaux, je regardais une bonne partie du centre-ville. Avec une vue sur un portrait géant d’Hugo Chávez, peint sur le bâtiment de la Banque du Venezuela. La nuit, deux projecteurs éclairaient ses yeux. Comme s’il surveillait tout, jour et nuit.
Le sentiment d’étouffer ne m’a jamais quitté au Venezuela. Les choses que j’ai toujours considérées comme allant de soi (prendre le bus, faire des courses, avoir accès à l’eau) sont soudain devenues très complexes. Nous ne pouvions pas non plus nous rendre aux belles plages dont Yeli m’avait parlé, ni au lieu de naissance de Jordi. Il en parlait toujours avec lyrisme. Ce serait trop cher et trop dangereux.
Nous avons fini par rester dans l’appartement à Caracas durant quinze jours. Nous avons bu du rhum au bord de la piscine commune pendant Noël. Parce que c’était trop difficile d’acheter de la nourriture. Nous n’avions pas l’énergie nécessaire pour faire quoi que ce soit d’autre.
On compare souvent le Venezuela avec la Corée du Nord, mais avec du rhum et du reggaeton. Le pays m’a appris à être sceptique. Le système ne permet pas de rêver ou de se sentir libre. Parfois, il semblait impossible d’en sortir. Un piège dont on ne peut s’échapper. C’est ce qui m’est venu à l’esprit lorsque j’ai reçu un énième message d’erreur lors de ma recherche d’un billet d’avion. Retour en Colombie.
Le lac s’est coloré en rouge pendant un moment au coucher du soleil, puis il s’est progressivement transformé en nuit. La voiture a traversé la zone frontalière déserte. À une vitesse bien trop élevée, le chauffeur de taxi esquive les nids-de-poule de la route. Il continuerait à rouler, même si quelqu’un se jetait devant sa voiture. “C’est un endroit sans loi”, prévient-il, “si je m’arrête ici, je ne peux pas garantir nos vies”. Quelques instants plus tard, nous avons traversé un village aux maisons en bois. Les habitants y boivent de l’alcool fabriqué à la maison. À partir de bouteilles en plastique recyclées. Ils se sont regroupés avec des mobylettes le long de la route. Ils écoutaient du reggaeton à tue-tête. La tension dans la voiture augmentait à mesure que la frontière approchait. Le chauffeur cessait également de parler de Maduro, l’homme le plus détesté du Venezuela. Encore un peu de patience, et nous serions de retour en Colombie.